
Formation de la Terre selon la théorie de l'accrétion homogéne
Tentons de schématiser les grandes étapes de l'apparition des algues sur
la planète Terre.
1. La formation de l'Univers
Jusqu'au début du XX° siècle, on considérait
l'Univers comme statique et formé d'étoiles.
C'est en 1927 que G. Lemaître avance l'idée que notre Univers est
"de masse homogène et de rayon croissant". Plus tard,
c'est Hubble qui démontre l'éloignement des galaxies les unes des
autres à des vitesses proportionnelles à leur éloignement à partir
de l'étude des modifications de leurs fréquences spectrales (effet
Doppler).
C'est à partir de 1950 que la théorie de l'expansion de
l'Univers a été admise; sa formation a
débuté par "l'explosion" d'une boule très chaude et trés dense de
gaz (hydrogène, hélium à 99% et de "poussiéres cosmiques solides")
; c'est le big bang qui aurait donné naissance aux galaxies
il y a 13,7 milliards d'années.
Mais, aujourd'hui l'Univers primitif est considéré comme étant
"tout l'espace" contenant un plasma chaud
et instable, à une température supérieure à 1032°K
!, une "soupe primitive" de particules et d'antiparticules,
de matière et d'antimatière; dans cet espace, matière, énergie et
temps sont intriqués selon la Théorie de la Relativité Générale.
2. Formation des particules élémentaires et des atomes.
Ainsi schématiquement apparaissent d'abord les premières
particules élémentaires comme les électrons
à charge négative, les bosons ou les quarks
(constituants des protons à charge positive et des neutrons) qui,
par association donneront les premiers noyaux et les premiers
atomes d'hydrogène apès capture d'un électron ; l'atome
d'hyrogène est formé d'un proton et d'un neutron.
Des lors les atomes d'hydrogéne s'attirent proportionnellement à
leur masse et au carré de leur distance (force gravitationnelle)
formant des nuages de plus en plus denses et de température de
plus en plus élevée (la température d'un gaz dépendant de sa
densité). Quand cette température atteint 15 millions de
degrés celsius le nuage devient une étoile.
Au fur et à mesure du vieillissement d'une étoile
la température augmente en son cœur jusqu'à plusieurs milliards de
degrés et les fusions donnent successivement des atomes
d'hélium, de carbone, de magnésium, de soufre, de phosphore et de
fer; atomes qui entreront dans la formation de molécules
essentielles à l'apparition de la Vie.
Ce sont les vieilles étoiles ou supernovea qui fabriquent les
noyaux lourds (fer, plomb, or...) par association d'atomes plus
légers ; en fin de vie elles explosent en libérant tous ces atomes
dans les espaces interstellaires vides et froids.
3. Formation du systéme solaire
Le systéme solaire lui apparaît il y a 4,57
milliards d'années ou 4,57 gyr à partir d'un nuage de gaz
dont une étoile centrale, notre Soleil (composé
principalement d'hydrogéne qui brûle).
Les "poussiéres" de matiéres cosmiques (planétoïdes et météorites)
et de molécules lourdes qui s'agglomérent au sein d'un disque
entourant le soleil, sont capturées par un objet compact central
par suite de la gravitation et par grossissement progressivement
ou accrétion vont former des planétes
dont la Terre.

La masse est telle, que les forces de
gravitation provoquent :
1. une fusion des matériaux et leur ségrégation : il s'en suit
une différenciation des enveloppes (noyau formé par la migration
vers le centre des noyaux les plus lourds, fer et nickel),
manteau formé par la migration vers l'extérieur des noyaux les
plus légers.
2. un dégazage (dioxyde de carbone, hydrogène sulfuré et vapeur
d'eau) avec formation d'une atmosphére vers 4,5 gyr.
3. l'écorce à laquelle s'ajoute des roches volcaniques et par
accrétion de matériaux provenant de l'intense bombardement
météoritique entre 4,5 et 3,2 gyr, forme la croûte qui commence
à se solidifier il y a 4,3 gyr.
4. Les océans se seraient formés à partir de 4,4 gyr.
4. Formation des molécules.
A leur tour les atomes nés dans les étoiles vont
par gravité s'attirer et donner naissance aux premières
molécules dont la molécule d'eau (H2O) par
association de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène
puis les molécules d'ammoniac, d'acétylène, d'acide formique, des
oxydes.... Les molécules forment de vastes nuages qui seront à
l'origine de nouvelles étoiles dont notre
Soleil.
L'atmosphére du soleil comme de la plupart des
étoiles est formée des atomes-gaz de carbone, hydrogéne et azote
qui s'éloignent progressivement du soleil pour former l'atmosphére
primitive de la Terre.
Les forces de gravitation les retiennent mais les gaz les plus
volatiles s'échappent vers sa surface (dégazage); le méthane (CH4),
l'ammoniac (NH3), la vapeur d'eau (H2O), le
monoxyde de carbone (CO), le diazote (N2), l'hydrogéne
sulfuré (H2S) et le formaldéhyde issus des matiéres en
fusion constituent la jeune planéte...
La vie n'était pas encore possible sur Terre à cause de l'intense
bombardement de météorites, l'absence de dioxygène, d'eau liquide,
et l'intense chaleur.
On n'a aucune preuve certaine des conditions
d'apparition ni des premiéres molécules (protéines et molécules
capables de transmettre des informations génétiques et de
catalyser les réactions comme l'ARN ou l'ADN) ni des formes de
vie; aussi en est-on réduit à envisager des scénarios sur les
modalités de cette création, à imaginer des théories
scientifiques, à essayer de les tester et de recréer au
laboratoire la formation de molécules organiques précurseurs du
vivant.
5. Apparition de la Vie.
5 .1. Quand ?
De la matiére organique vieille
de 3,85 milliards d'années a été découverte dans
des roches du Groenland qui renferment une proportion d'isotopes
radioactifs du carbone C12/C13 semblable à celle rencontrée chez
les êtres vivants.
Des vestiges de cellules vivantes
(eu-bactéries) âgées de 3,7/3,5 Ga ou gyrs ont
été découverts en Australie. Les premières formes vivantes
seraient apparues il y a un peu moins de 1 milliard d'années.
5.2. A partir de quoi et Où ?
Plusieurs hypothèses possibles : la vie est
apparue sur Terre (théories endogènes) ou ailleurs (théories
exogènes)? à partir de minéraux (théorie abiogène) ou à partir de
composés organiques (théorie biogène) et d'eau.
5.2.1. Théories abiogènes
5.2.1.1. Théorie de la génération spontanée
(Hypothèse 1).
De l'Antiquité jusqu'au XIX° siécle (D'Aristote à Van Helmont) la
théorie explicative de l'apparition de la Vie était la théorie
de la génération spontanée. Ainsi Van Helmont indiquait
que pour obtenir des souris, il suffisait de mettre en contact
pendant 21 jours, à l'humidité et à la chaleur, quelques grains de
blé et une chemise sale!
Il a fallu attendre les célébres expériences de Pasteur (1862)
avec ses flacons à "col de cygne" pour rejeter définitivement
cette théorie. Pasteur a établi que "La Vie vient de la
Vie" puisque tout être vivant est issu de la
reproduction d'organismes prééxistants.
5.2.1.2. Théorie abiogène de
l'origine terrestre des composés organiques (Hypothèse 2).
"Les premiéres formes de Vie auraient pris naissance à partir de
la matiére inanimée sur la Terre primitive où les conditions
étaient particuliéres".
En 1924 A.I. Oparine suggère
qu'à partir de composés minéraux inertes C, H, O, N du milieu
interstellaire se forment du méthane (CH4) de
l'ammoniac (NH3) et de la vapeur d'eau (H2O)
qui s'ajouteront aux produits de dégazage de la terre primitive (H2O,
CO); à leur tour ces atomes vont par gravité s'attirer et donner
naissance aux premières molécules dont la
molécule d'eau (H2O) par association de 2 molécules
d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Les molécules forment de
vastes nuages qui seront à l'origine de nouvelles étoiles
dont notre Soleil. pour former l'atmosphère primitive de la Terre.
C'est sous l'effet des radiations solaires (rayonnement U.V.), de
la chaleur (de refroidissement de la Terre, du volcanisme, de
l'énergie produite par les éclairs et la foudre) que la naissance
de composés organiques a été possible; les liaisons entre atomes
s'ouvrant permettent l'accrochage d'autres atomes ou combinaisons
d'atomes donnant naissance à des radicaux libres extrêmement
réactifs qui en se recombinant sont à l'origine de "briques" ou monoméres
comme les acides aminés formés de C H O N, puis de molécules plus
complexes, les polyméres à l'origine des
macromolécules, futurs matériaux des êtres vivants.
Ainsi il a été montré qu'il existe une forte probabilité (compte
tenu des matériaux chimiques et des conditions du milieu primitif)
pour qu'apparaissent les premiers acides aminés qui
donneront les protéines, les acides gras qui en se
combinant formeront les lipides, et les oses ou sucres
simples qui sont à l'origine des glucides (sucres et
polysaccharides comme l'amidon et la cellulose).
A la fin du XIX° siècle, Von Helmotz et Lord Kelvin suggèrent
aussi que des cellules vivantes ont pu voyager à l'intérieur des
comètes. Mais quelque temps après, Becquerel montra que le
rayonnement solaire détruisait toute forme de vie et en
particulier les bactéries.
En 1951, Calvin tente la synthèse de matériaux
organiques à partir d'éléments minéraux, de formaldéhyde (HCHO)
présente dans l'atmosphère primitive. Son expérience est
contestée.
En 1953, Stanley Miller à
partir d'une source d'énergie (décharges électriques simulant
des éclairs lumineux) dans une atmosphère contenant des
substances minérales (ammoniac, méthane et eau) obtient au
laboratoire 5 des acides aminés qu'on trouve dans des cellules
vivantes (briques nécessaires à la construction des
protéines!), du cyanure d'hydrogène HCN et de la formaldéhyde.
Ainsi, les premiéres synthéses "abiotiques" (c'est à dire sans
l'intervention de systémes vivants) de composés organiques ont
pu se réaliser à partir de l'atmosphère primitive.
En 1960 Joan
Oro obtient dans des conditions prébiotiques à partir
d'acide cyanhydrique soumis à un bombardement de photons de
l'adénine:
L'adénine est une base
azotée, brique élémentaire qui entre dans la constitution de
l'ARN et de l'ADN, molécules indispensables à l'information,
la synthèses des protéines et la reproduction du vivant.
Depuis, ont été obtenus abiotiquement, 17
acides aminés sur 20, des sucres, 2 bases azotées sur 4, des
acides gras, de l'ATP qui est le combustible cellulaire...
5.2.1.3.
Théorie de la naissance des matériaux de la Vie au sein de
l'Océan primitif (Hypothèse 3).
La Terre primitive ne permettant pas l'apparition de la vie
telle que nous la connaissons, (atmospère dépourvue de
dioxygène, températures très élevées, aucune protection contre
les rayons ultra-violets solaires biocides), c'est dans l'océan
primitif formé pendant des millions d'années, par l'eau de
l'atmosphére primitive qui en se condensant tombait en pluie
continuelle, où s'accumulaient à saturation, des sels minéraux
et des argiles issus du lessivage des Terres émergées, où les
manifestations volcaniques étaient intenses et les sources
hydrothermales présentes comme les "fumeurs noirs", qu'à une
certaine profondeur (200 m environ?), à l'abri des rayons
ultra-violets, il y a environ 4 milliards d'années, se
serait formée une "soupe primitive" qui donnerait
par des sythèses prébiotiques (sans intervention
d'enzymes), des protomolécules, briques du vivant
(acides aminés, bases azotées, sucres) qui engendreront
les premiéres formes de vie, les protocellules.
5.2.2. Théorie biogène de
l'origine des composants organiques (Hypothèse 4).
La Vie sur Terre aurait une
origine extra-terrestre (milieu interstellaire ou
exoplanètes).
Pour Richter en 1865 la Terre aurait
été ensemencée par des cométes et des météorites qui ont déposé
des germes de micro organismes formés spontanément dans le milieu
interstellaire.
En 1969
Murchinson découvre dans une météorite (chondrite carbonée)
âgée de 4,6 milliards d'année (âge du système solaire) tombées sur
terre, des molécules organiques (acides aminés, bases azotés et
glucides) dont certaines sont présentes dans les protéines des
êtres vivants.
Récemment, les radio astronomes ont pu montrer que plus de 100 types de molécules
organiques se forment dans les étoiles, puis se retrouvent dans le
milieu interstellaire et qu'environ 100 tonnes de micro météorites
bombardent chaque jour, la Terre.
Par ailleurs de nombreuses substances organiques ont été
découvertes emprisonnées dans les glaces du Groenland
6. Les premiéres structures
organiques.
Quelles seraient les premières structures organiques sachant que
les caractéristiques de la Vie sont:
- l'existence d'une membrane (séparant le milieu intérieur du
milieu externe) permettant les échanges,
- l'existence d'un métabolisme (c'est à dire la faculté d'élaborer
de la matiére protéinique à partir de composés plus simples et
d'énergie, en présence de catalyseurs indispensables)
- la capacité à se reproduire ?
Les premiéres molécules complexes se seraient polymérisées et
assemblées pour donner des micro-gouttes organiques
(Fox) ou coacervats (Oparin) à partir d'une
certaine profondeur d'eau qui les mettait à l'abri des
redoutables rayons ultra-violets. Ces chercheurs ont montré que
ces sphéres de lipides et de protéines isolant un milieu aqueux,
étaient capables d'échanges d'énergie et de matiéres avec le
milieu environnant et étaient douées de propriétés du Vivant; en
effet elles ont des fonctions d'autoconservation, d'autorégulation
et d'autoreproduction.
Aujourd'hui on peut reproduire au laboratoire la formation de
coacervats par condensation thermique à partir d'acides aminés
ou d'acides gras.
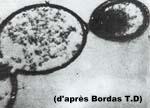
7. Les premiéres formes de vie
(Protobiontes)
7.1. Apparition de Protobiontes hétérotrophes.
Dés 1977, Carl Woese pense
que les micro-gouttes vont être remplacées par des
protoorganismes ancêtres des bactéries actuelles qu'il
nomme Archéobacteries ou Archæbactéries du groupe
primitif des Archées.
G. Wachtershauser montre
le rôle qu'auraient pu jouer des surfaces minérales comme
les argiles et les sulfures de fer dans l'apparition des
molécules biochimiques nécessaires à l'apparition de la vie :
FeS + H2S-----------------------> FeS2 + 2H+ + 2e
Sulfure de fer + sulfure d'hydrogène ------> pyrite + 2H+ + 2 électrons
Or on a découvert en 1977 à proximité des dorsales
océaniques la présence de sources hydrothermales chaudes et
de petits cônes volcaniques ,"les fumeurs noirs", qui
crachent des eaux sulfureuses contenant des métaux dissous,
à 3000 mètres de profondeur.
Au contact de l'eau froide, les
métaux dissous précipitent formant des concrétions de pyrite. Au
contact de ces sources se développent de nombreux êtres vivants
formant un riche écosystème à l'origine duquel se trouvent
des archébactéries et des bactéries qui synthétisent des
molécules organiques non pas à partir du dioxyde de carbone et
d'énergie fournie par la lumière solaire grace à la chlorophylle
comme chez tous les autotrophes, premier maillon des chaines
alimentaires mais par oxydation du sulfure d'hydrogène qui
libère énergie et électrons. Ces bactéries sont donc des
hétérotrophes, des organismes
chimio-autotrophes.
D'où une autre hypothèse (Hypothèse 5) a vu le jour, les
premiers organismes vivants seraient donc des chimio-autotrophes,
des Procaryotes (unicellulaires dépourvus de vrai noyau) anaérobies
(dont la vie se déroulait en absence de dioxygéne), hétérotrophes
(ne possédant pas de chlorophylle a, qui puisent nourriture et
énergie à partir des sulfures), vivant dans des conditions
extrêmes comparables aux conditions qui régnaient sur la terre
il y a 3,5 à 3,8 Ga.
A. Les Procaryotes
Ce sont des organismes (quelques micromètres) dont le
cytoplasme ne renferme pas de vrai noyau entouré d'une
enveloppe formée d'une double membrane (les premiers fossiles
de procaryotes ont été découverts il y a 3,45 Ga
dans les stromatolithes d'Australie (cf. ci-dessous). Ils ne
possèdent qu'un seul chromosome circulaire, libre dans le
cytoplasme. La division se fait par scissiparité
(bipartition d'un individu engendrant 2 nouveaux individus).
Il n'y a pas de véritable reproduction sexuée (pas de fuseau
achromatique) mais échanges de matériel génétique
par conjugaison (échange d'un fragment ADN
ou plasmide), par transduction (échange par
l'intermédiaire d'un virus ou phage) ou par absorption
d'ADN externe. Ces organismes sont répartis actuellement en 2
groupes: les archées et les bactéries
vraies.
Les archées
-ce sont des organismes procaryotes
(0,1 à 15 micrométres de diamétre et jusqu'à 200 micrométres de
long pour certaines formes filamenteuses) dont la structure est
considérée comme ancestrale; elle comprend un cytoplasme, une
membrane cytoplasmique composée de lipides particuliers et des
molécules porteuses de l'information génétique (ARN)
mais pas de vrai noyau à ADN.
-ce sont des organismes soit isolés, soit formant des agrégats
ou des filaments aérobies ou anaérobies; ils comprennent des
bactéries méthanogénes (présentent dans l'estomac des
ruminants), des halobactéries (des milieux trés salés), des
bactéries thermoacidophiles qu'on rencontre dans les sources
hydrothermales trés chaudes, aériennes ou sous-marines
profondes, des bactéries des eaux antarctiques....
Ils pourraient ressembler vraisemblablement aux actuelles
bactéries de la fermentation ou à celles qui utilisent
l'énergie produite par chimiosynthése comme les
bactéries qu'on trouve dans les fosses marines, les cheminées
abyssales ou les geysers (où pression, température et teneurs en
sels minéraux sont élevées).
Certains chercheurs, suite à la découverte dans des roches volcaniques
d'origine hydrothermale, datées de 3,2 Ga, de traces fossiles
attribuées à un microorganisme, pensent que ces archéobactéries
seraient des descendants d'un ancêtre commun et Cavalier-Smith
(2004) pense que la "source" du vivant se trouve au niveau
des eubactéries (cf. l'arbre de vie
proposé par cet auteur).
Les eubactéries
-ce sont des organismes procaryotes
(dépourvu de noyau bien individualisé à ADN) mais
possédant des ARN
-on les trouve dans toute la biosphére et certaines dans
le tube digestif des animaux
-on y trouve aujourd'hui des protéobactéries, des
mycoplasmes, des actinobactéries, les cyanobactéries
connues aussi sous le nom d"'algues bleues".
Certaines sont photosynthétiques autotrophes comme les
Cyanobactéries filamenteuses dont l'activité métabolique
(elles provoquent la précipitation des bicarbonates
solubles sous forme de carbonate de calcium qui les
emprisonnent) a donné naissance à des formations
sédimentaires fossiles et calcaires connues en Australie
sous le nom de stromatolithes (du grec stroma=filament
et lithos=pierre).
Les plus anciennes sont
datées de 3,7 milliards d'années! Elles
renferment des traces de substances issues du
métabolisme photosynthétique, des produits de
dégradation de la chlorophylle et des oxydes.
-d'autres sont hétérotrophes, elles recyclent la matiére
organique qu'elles décomposent en minéraux et énergie
-d'autres sont chémo-autotrophes, capables d'oxyder des
composés minéraux (nitrites, nitrates...) pour en tirer
l'énergie nécessaire.
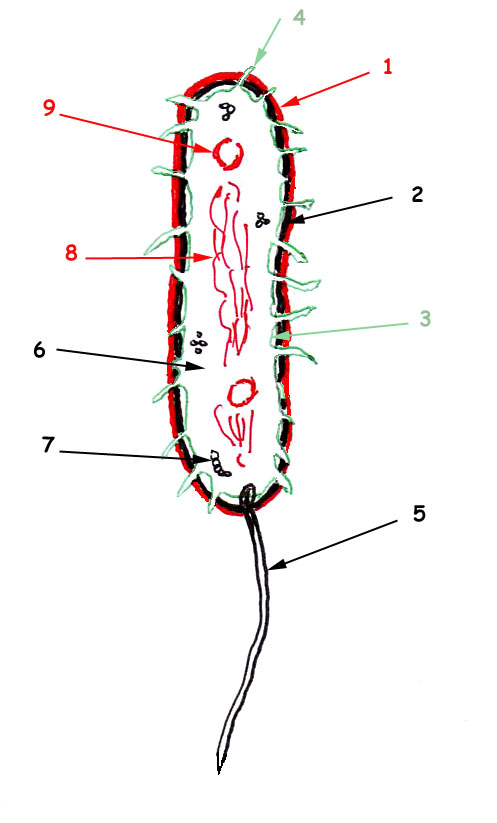
Dans de nombreux protoorganismes vont apparaître successivement
les molécules et les grandes fonctions nécessaires à
l'épanouissement et à l'expansion de la Vie: ainsi les bases
azotées donneront naissance à des molécules essentielles à
la vie (comme l'ARN = Acide RiboNucléique puis l'ADN=
Acide DésoxyriboNucléique qui seront les molécules de l'hérédité
permettant la conservation et la transmission des caractéres
héréditaires entre les générations, les protéines
notamment les enzymes et l'ATP
= Adénosine TriPhosphorique, molécule qui permettra le transport
de l'énergie dans le vivant).
Suite à la découverte d'ARN à pouvoir catalytique (ARNs ou
ribozyme) capables de transmettre aussi une information
dans les 3 lignées du vivant, dés 1986 Walter Gilbert émis
l'hypothése de l'existence d'un monde à ARN (apparu vers
4,4 gyr) de type rétrovirus, capable de donner naissance à la molécule
d'ADN et aux protéines donc d'être
à l'origine d'un métabolisme primitif. En 2000,
on démontra que le site des ribosomes de la cellule responsable
de la liaison peptidique entre 2 acides aminés était entiérement
formé d'ARN, ce qui semble confirmer qu'à l'origine il y avait
bien "un monde à ARN" (rétrovirus, virus, archées, bactéries)
qui précéda le monde à ADN....
7.2. Apparition de Protoorganismes autotrophes
chlorophylliens.
Outre l'ARN qui posséde aussi des fonctions catalytiques
(accélératrices de certaines réactions chimiques), apparaîtront
aussi les enzymes, catalyseurs biologiques, la chlorophylle
molécule capable de capter l'énergie des radiations solaires.
Ainsi ces protoorganismes chlorophylliens vont-ils être capables
d'élaborer les substances organiques qui leur sont
indispensables à partir d'eau, de substances minérales (sels
minéraux et dioxyde de carbone) en utilisant l'énergie solaire
captée par la chlorophylle. On les dits autotrophes
(du grec autos= soi-même et trophê = nourriture).
7.3. Apparition des
Cyanobactéries.
Rappelons que les roches les plus
anciennes sont datées de -3,85 gyrs
et qu'elles renferment des traces de matière organique, que les
plus vieux fossiles procaryotiques ont été
trouvés dans des stromatolithes datées de -3,5 gyrs
et que se sont des eubactéries de type cyanobactéries capables
d'une activité photosynthétique (la chlorophylle est portée par
les thylacoïdes qui se trouvent dans le cytoplasme) n'étant
possible que grace à la présence d'un pigment complémentaire
bleu, la phycocyanine. Les premiers végétaux apparus dans
l'océan, il y a 3,7 milliards d'années avant notre ère,
seraient des cyanobiontes
(du grec Kuanos=bleu sombre et biont=être vivant)
plus précisément des algues
bleues ou cyanophytes
qui proviendraient d'une bactérie pourvue de chlorophylle qui se
serait associée à une bactérie contenant un pigment bleu donnant
un nouvel organisme capable d'utiliser avec le complexe
chlorophylle + pigment bleu, la faible luminosité parvenant à
cette profondeur à l'abri des rayons ultra violets. Les traces
de Cyanobactéries fossiles datent au moins de
-2,7 gyr.
Ainsi pendant 2 milliards d'années (de
l'apparition des Cyanophycées photosynthétiques jusqu'à
l'apparition des eucaryotes unicellulaires) les Cyanobactéries
vont provoquer l'élévation du taux de dioxygéne dans
l'atmosphére et permettre la formation de la couche d'ozone
capable d'arrêter les rayons ultraviolets toxiques pour toutes
formes de vie. Elles vont entrainer, outre la diminution du ph
acide de l'océan en piégeant le dioxyde de carbone dans le
calcaire et en fixant l'azote atmosphérique, un processus
favorable à l'apparition d'autres formes de vie.
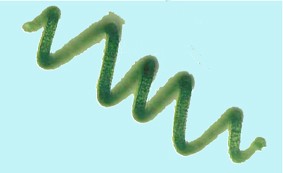 Spiruline actuelle : filament spiralé mobile chlorophyllien aux parois sans cellulose (diamétre = 0,01 mm, longueur = 0,3 mm) vit dans des lacs alcalins (Procaryote autotrophe du groupe des Cyanobactéries proche des fossiles découverts dans les plus anciennes roches sédimentaires, en Afrique du Sud, âgées de 3,7 milliards d'années. |
 Stromatolites contenant des Procaryotes fossiles photosynthétiques du groupe des Cyanobactéries |
8. Apparition des
premiéres cellules
Il semble donc qu'un monde à
ADN ait succédé au monde à ARN par
l'apparition de virus à ADN plus résistants aux défenses
des bactéries qu'ils infectaient. Puis des virus
auraient introduit des ADN dans des bactéries ou des
archées et les premiéres cellules vivantes eucaryotiques
(nées suite à des mécanismes de fusion entre bactérie et
archée).
Les eucaryotes
Ce sont tous les autres organismes
apparus à partir d'organismes procaryotes ayant perdu
leur paroi; ils possédent un cytoplasme renfermant un noyau
individualisé (entouré d'une double membrane), des
organites cellulaires (mitochondries, chloroplastes,
flagelles ou cils, un système membranaire endocellulaire
avec réticulum endoplasmique, corps de Golgi,
lysosomes..). Lors de la division cellulaire qui est une
mitose, l'ADN (molécule codée qui porte
l'information génétique) se fragmente en chromosomes.
Ils présentent une véritable reproduction
sexuée, chaque partenaire sexuel apportant
une moitié du matériel génétique par l'intermédiaire des
gamètes (suite à une méiose).
-la cellule eucaryote posséde un vrai noyau (4)
contenant l'ADN entouré d'une membrane;
- cette structure est considérée comme dérivant de la
structure procaryote; elle est caractérisée par un
cytoplasme (3) et sa membrane
cytoplasmique (2), un noyau,
un appareil de golgi (7), un
réticulum (5) et des
mitochondries (6).
-les eucaryotes ont une véritable sexualité
-leur cycle de vie comprend 2 phases chromosomiques, la
phase diploïde (2n chromosomes) et la phase haploïde (n
chromosomes).
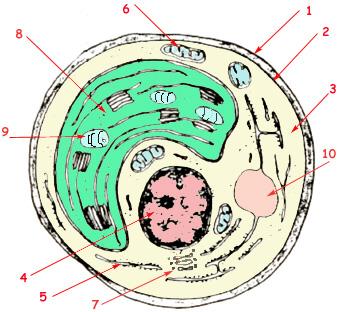 Schéma de
l'ultrastructure d'un eucaryote (cellule
végétale)
Schéma de
l'ultrastructure d'un eucaryote (cellule
végétale)1 = membrane pectocellulosique 8 = chloroplaste 9 = grains d'amidon; 10 = vacuole |
 Structure d'une algue
verte en microscopie
optique
Structure d'une algue
verte en microscopie
optique |
La fusion et l'association = endosymbiose
(cf. ci-dessous) d'un organisme procaryote hôte, avec
des procaryotes (hétérotrophes, porteurs de
chlorophylle), auraient donné le premier
organisme unicellulaire, le premier Protiste
(avec ses organites cellulaires et avec son réseau
membranaire d'échanges issu d'invaginations de la
membrane cellulaire).
Des études récentes portant sur l'analyse de la
phylogénie (= étude de la filiation des gènes) chez
les archéobactéries, les eubactéries et les eucaryotes
ont conduit à émettre l'hypothése que tous les êtres
vivants dériveraient d'un ancêtre commun LUCA
(Last Universal Common Ancestor)............
La découverte de substances bithumineuses vieilles de
-2,6 gyr qui n'ont pu être
synthétisées que par des membranes d'eucaryotes permet
de situer l'apparition de ces organismes. Les fossiles
d'eucaryotes les plus anciens seraient des algues
datées de 1,8 à 2,1 gyr.
Conclusion.
Ainsi de -3,8/3,7 Gyr jusqu'à l'apparition de
cellules eucaryotes unicellulaires autotrophes il y a
-2,6 gyr avant notre ére une formidable
diversification du monde bactérien a lieu dans
l'océan.
L'endosymbiose. Les cellules eucaryotes sont
des chimères qui auraient acquis leurs organites
cellulaires comme les mitochondries à partir de
protéobactéries ou les chloroplastes à partir de
cyanobactéries par endosymbiose (de
endo=à l'intérieur et symbiose=vie; la symbiose
étant une association à bénéfices réciproques entre 2
partenaires, l'endosymbiose se faisant entre un hôte
et un symbionte qu'il abrite).
Origine des
plastes. Dès la fin du XIX° siècle, on avait
remarqué que la taille des plastes correspond à la
taille d'une cyanobactérie, que les plastes et les
mitochondries des Chlorobiontes (végétaux verts
terrestres+algues vertes), des Rhodophytes et des
Glaucophytes possèdent un génome, un ADN de type
circulaire, comme les procaryotes, que leurs plastes
se multiplient par bipartition comme le font les
Cyanophycées, qu'ils sont les seuls à posséder avec
ces dernières, une double paroi et un système
membranaire indépendant de la membrane plasmique, les
thylacoïdes.
Ce qui suggère d'ailleurs que ces 3 phylums dérivent
de cette endosymbiose.
On a alors émis l'hypothèse que les
plastes seraient d'origine endosymbiotique,
c'est à dire qu'à l'origine ils dériveraient d'une
bactérie, une cyanobactérie (qui est photosythétique
grace à la présence de thylacoïdes épars dans le
cytoplasme) capturée par une cellule hôte (eucaryote
hétérotrophe); abritée dans une vacuole, le symbionte
aurait établi alors une relation symbiotique avec
l'eucaryote hétérotrophe. L'analyse récente des
séquences génétiques des membranes du plaste et des
Cyanophytes a montré qu'ils avaient même origine et
constituaient un même clade, vérifiant ainsi
l'hypothèse précédente.
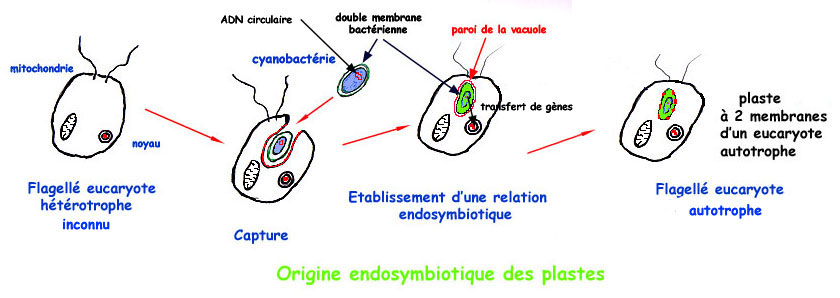
Une partie du patrimoine génétique du symbionte
passant dans le noyau de la cellule hôte au cours de
l'endosymbiose; cette dernière devient alors un nouvel
organisme autotrophe capable de photosynthèse.
Le premier virus géant découvert par
le professeur Didier Raoult à Marseille en 2003 a ouvert un
vaste champ de recherches qui a permis la mise à jour de plusieurs
familles de ce type de virus dans de nombreux milieux et notamment à des
profondeurs de plus en plus grande dans le permafrost.
Ces virus sont visibles au microscope
optique, en effet leur taille, 1 micromètre, est celle d'une bactérie
(contrairement aux virus connus jusque là); certains renferment 2500 gènes
(contre une dizaine pour le virus de la grippe ou du SIDA !) des gènes
communs aux plantes et aux animaux !!
Compte tenu que le parasitisme des virus se retrouve aussi chez des
bactéries et que certains virus ATV (Acidianus Two-tailed Virus),
parasites d'une Archée qui vit près des sources hydrothermales acides sont
capables d'effectuer une partie de leur assemblage en dehors de la cellule
hôte puis de "bourgeonner" dans la cellule en fabriquant 2 appendices
protéiques.
Les virus qui jusque là ne faisaient pas partie du vivant le serait!
Une nouvelle hypothèse à vu le jour :
l'existence d'une grande biodiversité à tout les niveaux y compris
chez les virus et qu'il y aurait un
continum depuis les premières particules élémentaires, le protovivant
jusqu'au vivant.