
Les courants marins dans l'Atlantique Nord.
Signalons quelques différences
essentielles entre Atlantique et Méditerranée:
-la salinité
de l'Atlantique est plus basse qu'en Méditerranée (35°/°°
contre 36,4°/°° à 39, 5°/°°)
-la température
bien que la Dérive Nord-Atlantique issue du Gulf Stream réhausse
la moyenne des températures annuelles de 6 à 10 °C sur les côtes
atlantiques françaises (par rapport aux régions littorales
américaines situées à la même latitude), les eaux profondes en
Atlantique ont une température moyenne de 3 à 4 °C en hiver contre
13°C en Méditerranée.
-le brassage des eaux est plus
rapide et plus important dans l'Océan grace à l'existence de
grands courants, de différences de température importantes entre
la surface et les eaux profondes; en hiver les remontées de sels
nutitifs sont beaucoup plus efficaces.

-les marées sur les côtes atlantiques sont fortes et les algues qui peuplent l'estran ou "zone de balancement des marées" sont soumises à des conditions écologiques très sévères (longue durée des émersions, effets prolongés du soleil, du vent, apports d'eau douce entrainant une dessication poussée..)
1. Zonation verticale du domaine benthique
Les êtres vivants benthiques (fixés sur le fond) se répartissent en étages aux peuplements caractéristiques.
Les limites entre les étages correspondent
à des variations des conditions écologiques du milieu.
Les petits fonds qui reçoivent suffisamment de
lumière pour permettre le développement de végétaux
chlorophylliens, constituent le système phytal qu'on divise en plusieurs étages:
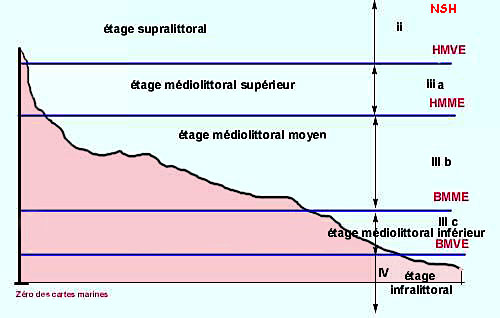
HMVE = Haute mer de Vives Eaux;
HMME = Haute mer de Mortes Eaux
BMME = Basse Mer de Mortes Eaux;
BMVE = Basse Mer de Vives Eaux
II = L'étage supralittoral. Mouillé par les
embruns et les vagues déferlantes.
III = L'étage médiolittoral. Immergé par hautes eaux et
mouillé par les vagues à basses eaux.
IV = L'étage infralittoral. Toujours immergé, sa limite
inférieure est la limite compatible avec la vie des algues
pluricellulaires photophiles (="amies de la lumière"
qui exigent une intensité lumineuse importante pour se développer)
et des Posidonies.
V = L'étage circalittoral. Toujours immergé, sa limite
profonde est la limite compatible avec la vie des algues
pluricellulaires sciaphiles plus tolérantes pour les faibles
éclairements.
Les grands fonds constituent le système aphytal caractérisé par l'absence de lumière et donc de végétation chlorophyllienne; ils comprennent 3 étages:
VI = L'étage bathial qui correspond aux peuplements occupant le talus continental et la pente qui se trouve au pied de
ce talus,
VII = L'étage abyssal comprend les peuplements de la grande
plaine où dominent les fonds meubles ,
VIII = L'éage hadal qui englobe les ravins et les fosses
profondes.
On distingue selon la profondeur et la nature du fond. :
-une province néritique peu profonde qui recouvre le plateau continental, jusqu'à une profondeur de -200 mètres, où les peuplements sont riches et variés et
-une province océanique au large où les eaux sont assez pauvres.
Chacune comprenant:
-un domaine pélagique où se trouvent des organismes vivant librement dans les eaux; ils sont, soit passivement entraînés par les vagues et les courants constituant le plancton soit capables de se déplacer indépendamment des courants, ils constituent alors le necton soit flottant à la surface des eaux
(neston).
-un domaine benthique où vivent des organismes
fixés sur le fond (sessiles), près du fond (sédentaires ou
vagiles) ou encore enfouis dans les sédiments
(fouisseurs).
Les côtes atlantiques françaises comme les côtes
méditerranéennes font partie de la même région biogéographique, la
région méditerranéo-atlantique de climat chaud.
Aussi, un lot d'espèces
communes (> 60%?), le plus important d'ailleurs,
se retrouve-t-il aussi bien dans l'Océan qu'en Méditerranée où
dans certaines zones on rencontre des Laminaires si
caractéristiques de l'Océan. De nombreuses espèces ont, dès la
fin du tertiaire, pénétré en Méditerranée par le détroit de
Gibraltar.
Signalons des espèces
originaires de mers chaudes (mer Rouge, Atlantique
tropical et subtropical, Océan Indien, Océan Pacifique) comme Halimeda
tuna, Udotea
petiolata, Acetabularia
acetabulum, Caulerpa
prolifera ...... ou des espèces
cosmopolites qu'on retrouve dans toutes les mers du
monde comme Ulva lactuca,
Codium dichotomum, Colpomenia
sinuosa, Scytosiphon
lomentaria ... ce qui suppose des relations entre ces différentes zones au cours des temps géologiques.
Notons qu'un petit lot d'espèces différentes se retrouvent en Méditerranée et dans l'Océan. Ces espèces qui occupent les mêmes niches écologiques dans 2 mers différentes sont dites vicariantes: citons
le cas de Phyllophora épiphylla en Atlantique nord et Phyllophora nervosa en Méditerranée
Un nombre d'espèces assez important dites endémiques,
présentant des liens de parenté évidents, se retrouvent dans l'une
des 2 mers; c'est le cas Cystoseira
stricta, espèce méditerranéenne qui dériverait de Cystoseira
tamariscifolia, espèce d'origine atlantique qui aurait
pénétré en Méditerranée en subissant des modifications dûes aux
contraintes différentes du nouveau milieu. Citons aussi le cas des
endémiques méditerranéennes (20 à 25% du total!) comme Rissoella
veruculosa ou de la Posidonie, phanérogame marine
(plante à fleurs) du genre Posidonia océanica! le végétal
emblématique de Méditerranée.
Le détroit de Gibraltar continue à alimenter la
Méditerranée, y compris en "espèces venues
d'ailleurs" comme Asparagopsis
armata, originaire du Pacifique, Codium
fragile ou Colpomenia
peregrina .
Notons d'autres "envahisseurs" en Méditerranée, arrivés par le
canal de Suez ("espèces lessepsiennes") venant de la mer Rouge
comme Halophila stipulacea ou introduites accidentellement
comme Sagarsum muticum
(originaire du Japon) ou Caulerpa
taxifolia ("une création ?" d'un aquarium
européen)....
 |